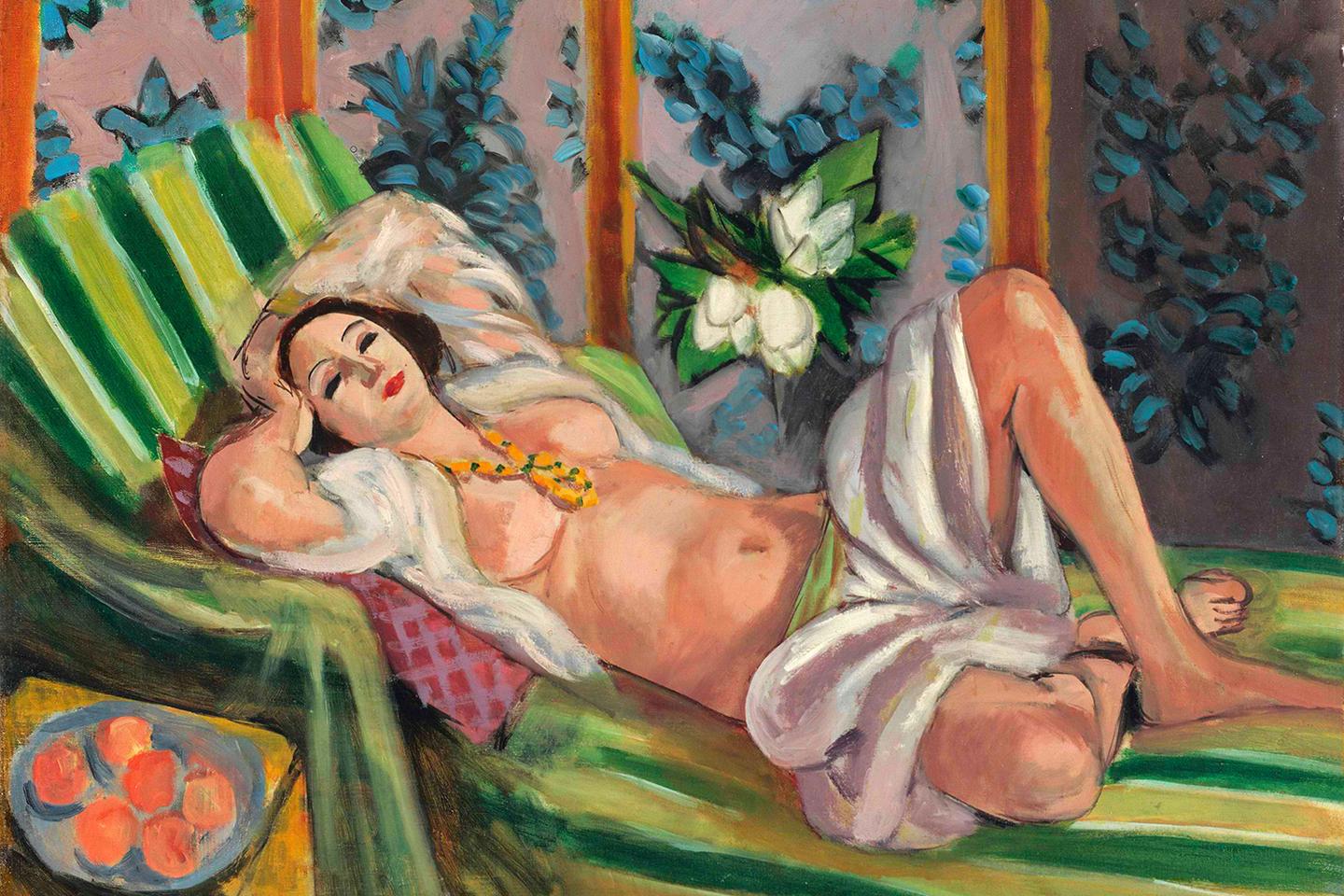C’est la douceur qui surprend. Le toucher de sa main quand il vous la tend. La bienveillance de son regard quand il vous observe, le ton calme et acceptant de sa voix face au vacarme du Festival. Au milieu du barnum cannois, le don Vito Corleone du Parrain II (1975), l’Al Capone des Incorruptibles (1987), le Jake LaMotta de Raging Bull (1981), le Travis Bickle de Taxi Driver (1976)… – quelque 115 personnages pleins de rage, de fureur, de folie et de merveilleux –, débarque l’air de rien et sans faire de bruit.
L’homme qui, en pleine campagne électorale aux Etats-Unis, avait décidé de crier plus fort que tout le monde pour dénoncer le « fascisme » à venir du candidat Trump, le traitant de tous les noms, d’abruti, de gangster, de fou, range ses lunettes dans la poche extérieure de sa veste marron et, gratifiant de son sourire tendre la demi-douzaine de journalistes qu’il rencontre de manière informelle ce mercredi 14 mai au matin, touille tranquillement son café crème.
La veille, alors que le Festival lui remettait la Palme d’honneur, il avait une fois de plus, sous les applaudissements unanimes, appelé au sursaut face aux menaces planant désormais partout dans le monde sur la démocratie, terminant son discours par ces trois mots qu’on avait peut-être un peu trop rapidement rangés au placard des vieilles antiennes galvaudées : « Liberté, égalité, fraternité ». Ovations de la salle.
Il vous reste 76.2% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.