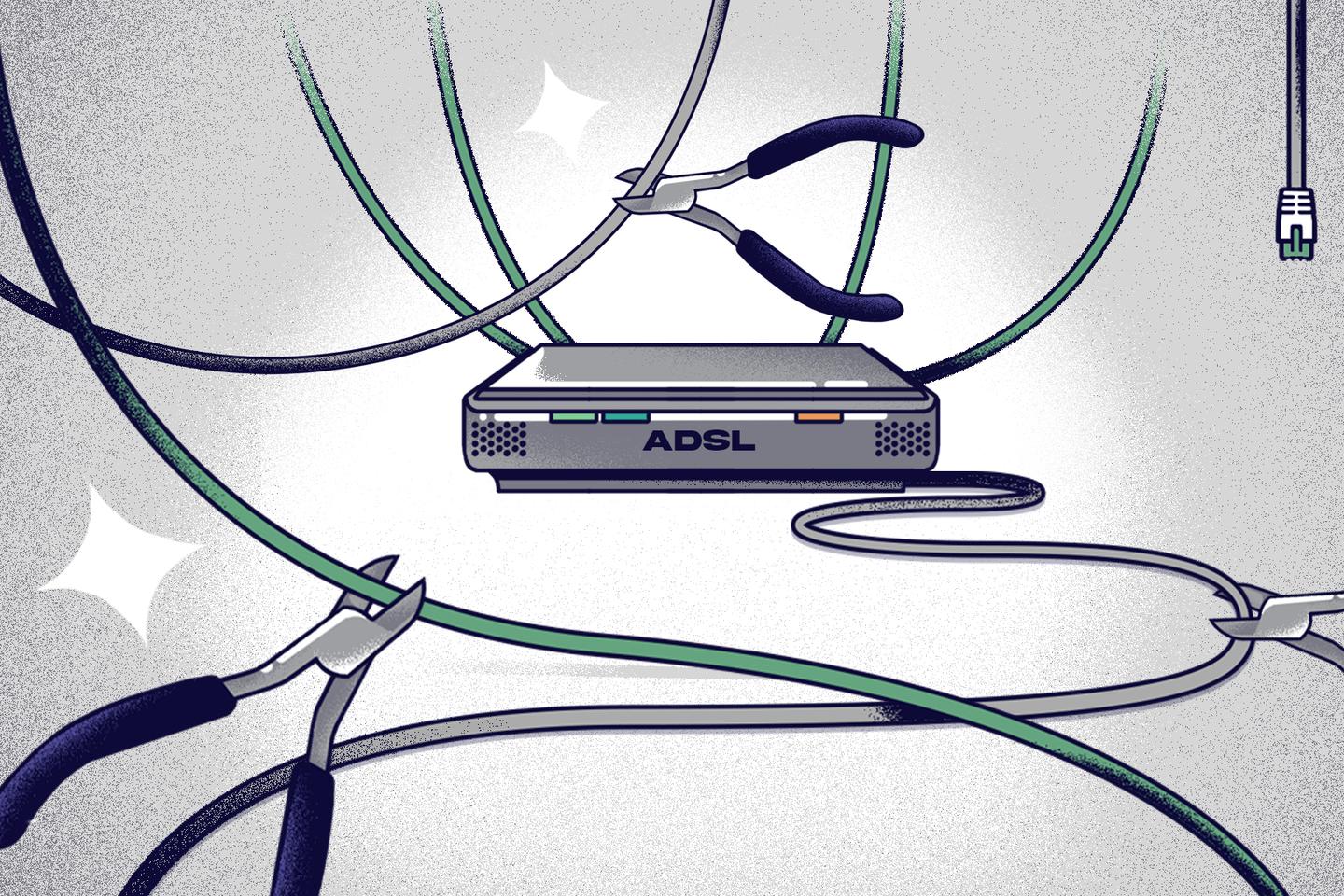« Anthologie bilingue de la philosophie en Islam », de Fârès Gillon et Mathieu Terrier, traduit de l’arabe par les auteurs, préface de Christian Jambet, Diacritiques, « Sources et histoire des sources », 706 p., 40 €, numérique 10 €.
L’Anthologie bilingue de la philosophie en Islam, de Mathieu Terrier et Fârès Gillon, tous deux universitaires et historiens des idées en Islam – la majuscule désigne, comme ils le précisent, l’Islam comme horizon historique et civilisationnel et non comme religion –, dépasse de loin la simple anthologie au sens étymologique de « recueil de textes choisis ». Certes, les auteurs ont sélectionné des textes, qu’ils présentent dans leur version originale arabe ou persane, accompagnés de traductions françaises, mais leur projet est plus ambitieux : mener une réflexion profonde sur ce qu’est fondamentalement l’acte de philosopher dans un contexte islamique.
La portée de leur démarche se mesure dès la substantielle introduction, longue de plus de 50 pages, dans laquelle ils exposent les principes méthodologiques qui ont guidé non seulement le choix des textes et des thèmes, mais plus encore leur approche de la philosophie en Islam. Une question décisive se pose immédiatement : de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on réunit dans un même recueil, entre autres penseurs, des extraits d’Al-Farabi (v. 872-950), célèbre pour sa philosophie politique ; d’Averroès (1126-1198), brillant commentateur d’Aristote ; de Ghazali (1058-1111), critique des philosophes péripatéticiens (du nom de l’école fondée par Aristote) mais également auteur de traités majeurs de théologie rationnelle et de mystique ; de Suhrawardi (1155-1191), fondateur de la doctrine illuminationiste ; ou encore d’Ibn Arabi (1165-1240), dont la mystique spéculative a profondément influencé l’histoire intellectuelle du monde islamique ?
Il vous reste 64.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.