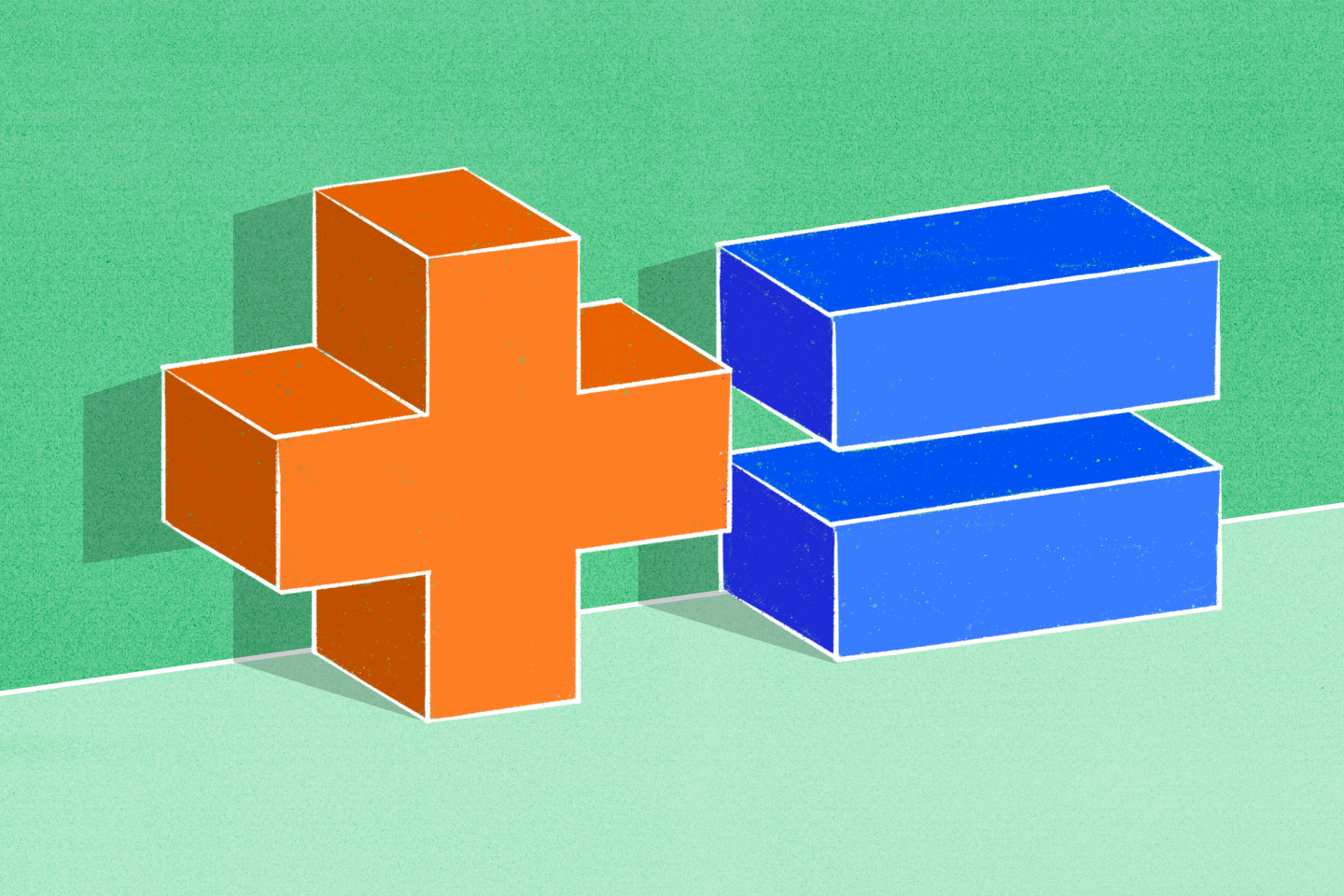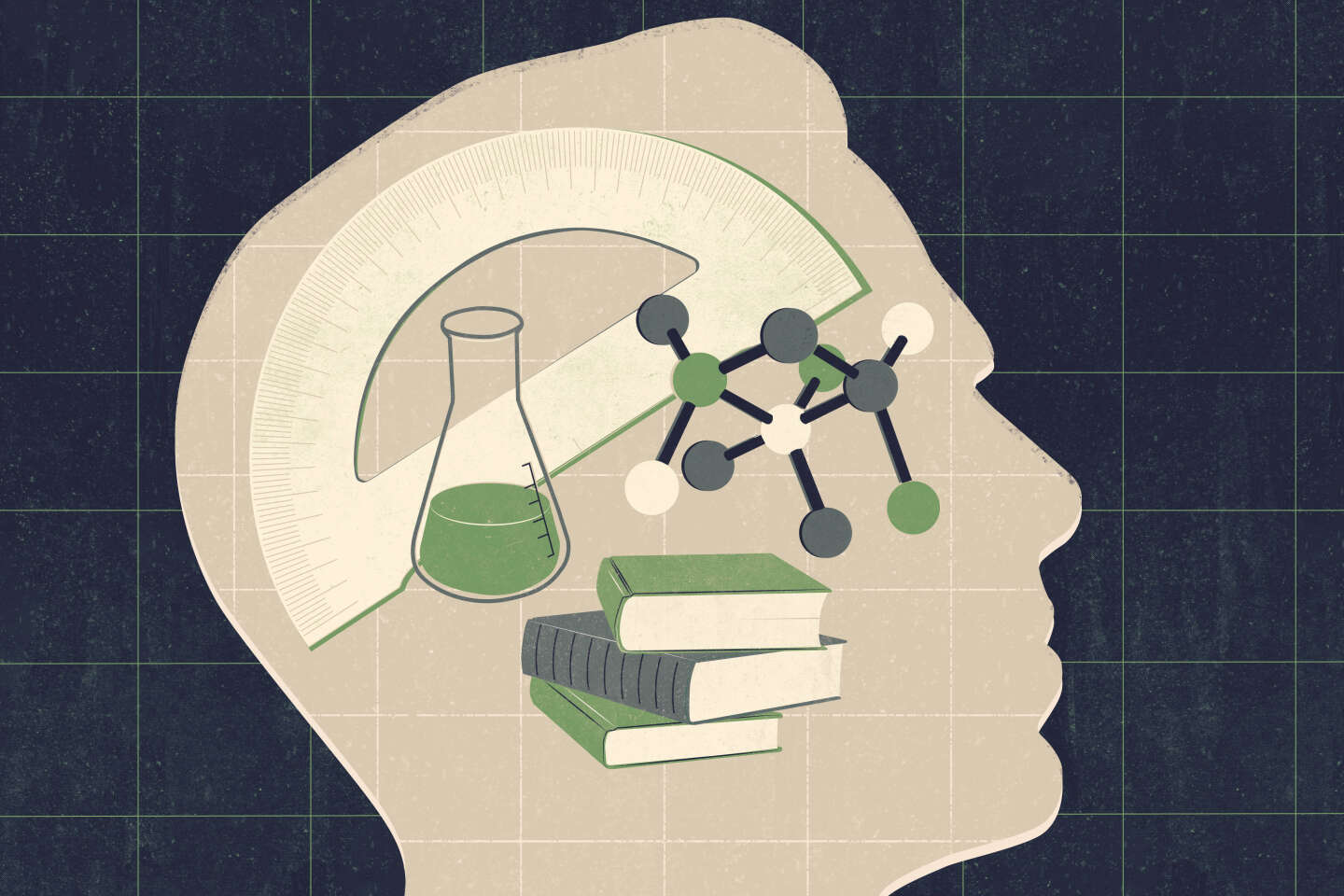C’est un trésor qui prospère, à la dérobée, dans les eaux du monde entier. Océans, lacs, rivières et marais, humidité des sols, fontaines et jusqu’aux écoulements de nos caniveaux urbains : tous ces milieux aquatiques, de l’équateur aux pôles, recèlent des myriades de ces joyaux microscopiques. Soit autant de minuscules diamants taillés par une « main de génie », mariant le raffinement le plus pur à la fantaisie la plus folle.
Certains de ces bijoux dessinent des étoiles, d’autres, des disques plats ou bombés ; d’autres encore s’étirent telles des plumes ou se tordent en pales d’hélice flexueuses. Beaucoup se parent de stries, de canaux ou de nervures, certains se hérissent d’épines, d’autres s’ornent de tiges à bout fleuri. La plupart sont percés de pores nanoscopiques. Le tout tisse des dentelles arachnéennes d’une infinie variété, d’une grâce de fée.
Ces « diamants », en réalité, sont des êtres vivants. Ce sont des microalgues de couleur brun-jaune, formées d’une cellule unique, dont la taille varie de quelques millièmes de millimètre à un demi-millimètre. Cette cellule, fait singulier, est cuirassée d’une coque minérale : c’est le « frustule », formé de deux valves qui s’emboîtent. D’où le nom de ces créatures, baptisées « diatomées » – du grec diatomos, « coupé en deux » – par le naturaliste suisse Augustin Pyrame de Candolle, en 1805. Ces frustules, en réalité, sont taillés dans un matériau bien moins noble que le diamant : de la silice amorphe, à la composition proche du verre.
Il vous reste 90.78% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.