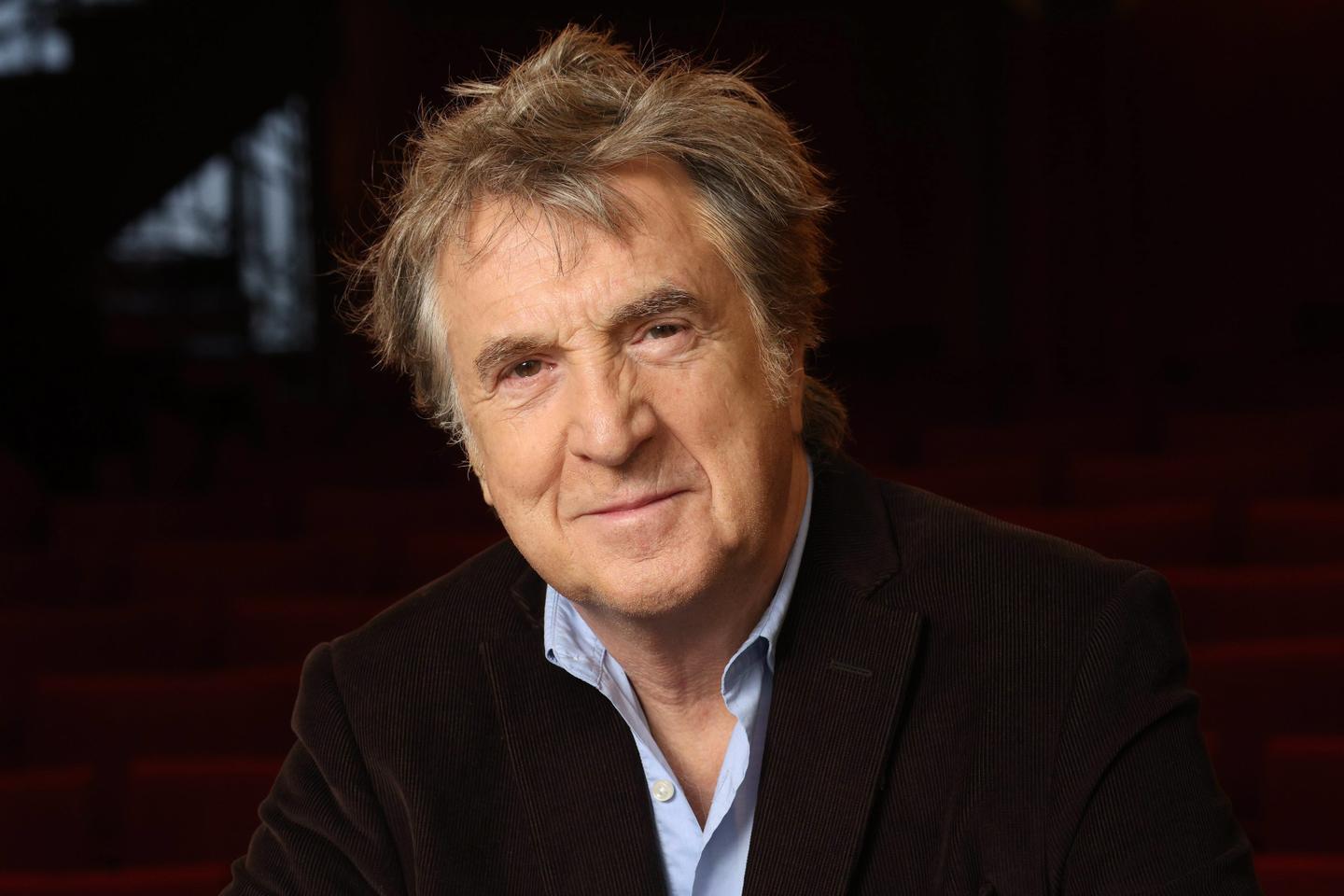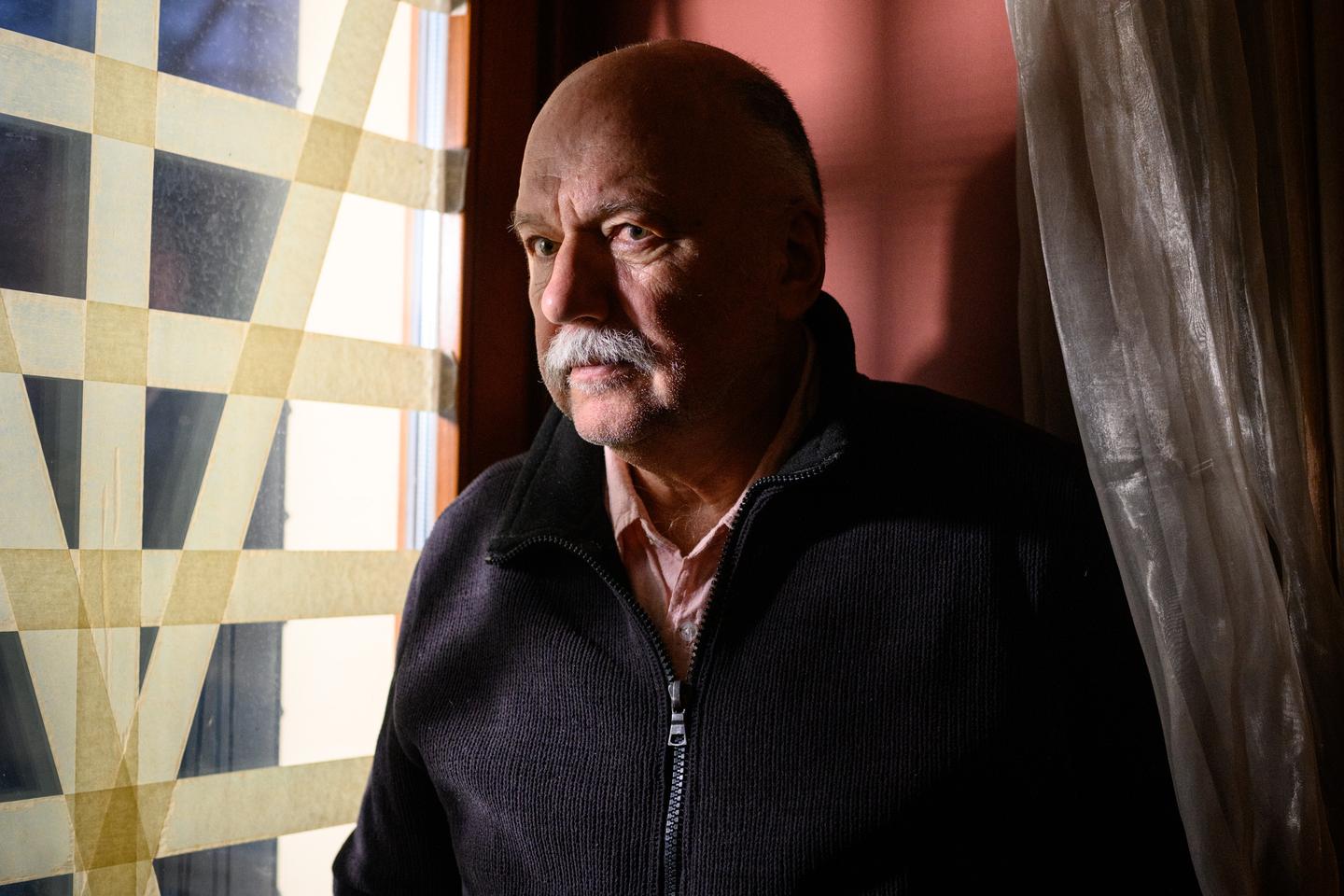C’est l’une des images les plus éculées du Japon : un océan de graviers finement ratissés sur lequel des roches non taillées se dressent. Chaque année, des millions de touristes traversent la planète pour contempler ces cailloux savamment agencés dans les temples nippons.
Dans la culture commune, le jardin sec est presque systématiquement associé à la spiritualité du bouddhisme zen, au point d’être souvent baptisé « jardin zen ». Il est perçu comme un support méditatif devant lequel l’observateur serait invité à faire le vide dans son esprit durant de silencieuses minutes. Mais ces jardins, dont une large part n’a été popularisée qu’après la seconde guerre mondiale, sont-ils vraiment aussi zen qu’on le dit ?
L’histoire : des moines peintres devenus jardiniers
Si l’origine précise du jardin sec reste floue, elle demeure en tout cas inévitablement associée à l’histoire des temples zen. Dans le contexte du Japon médiéval, ces complexes religieux sont à la fois des lieux spirituels et des plateformes administratives et politiques.
Au XIIIe siècle, en plein essor d’un mouvement zen s’étendant dans la capitale impériale de Kyoto, des temples comme le Kennin-ji ou le Tofuku-ji servent de plateformes tournées vers le continent, la maîtrise du chinois classique permettant aux prélats du zen d’assurer la diplomatie du shogun, le dirigeant de l’Archipel. En plus des échanges politiques ou purement marchands, les contacts avec la Chine permettent aux religieux de faire évoluer les beaux-arts japonais.
Il vous reste 81.04% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.