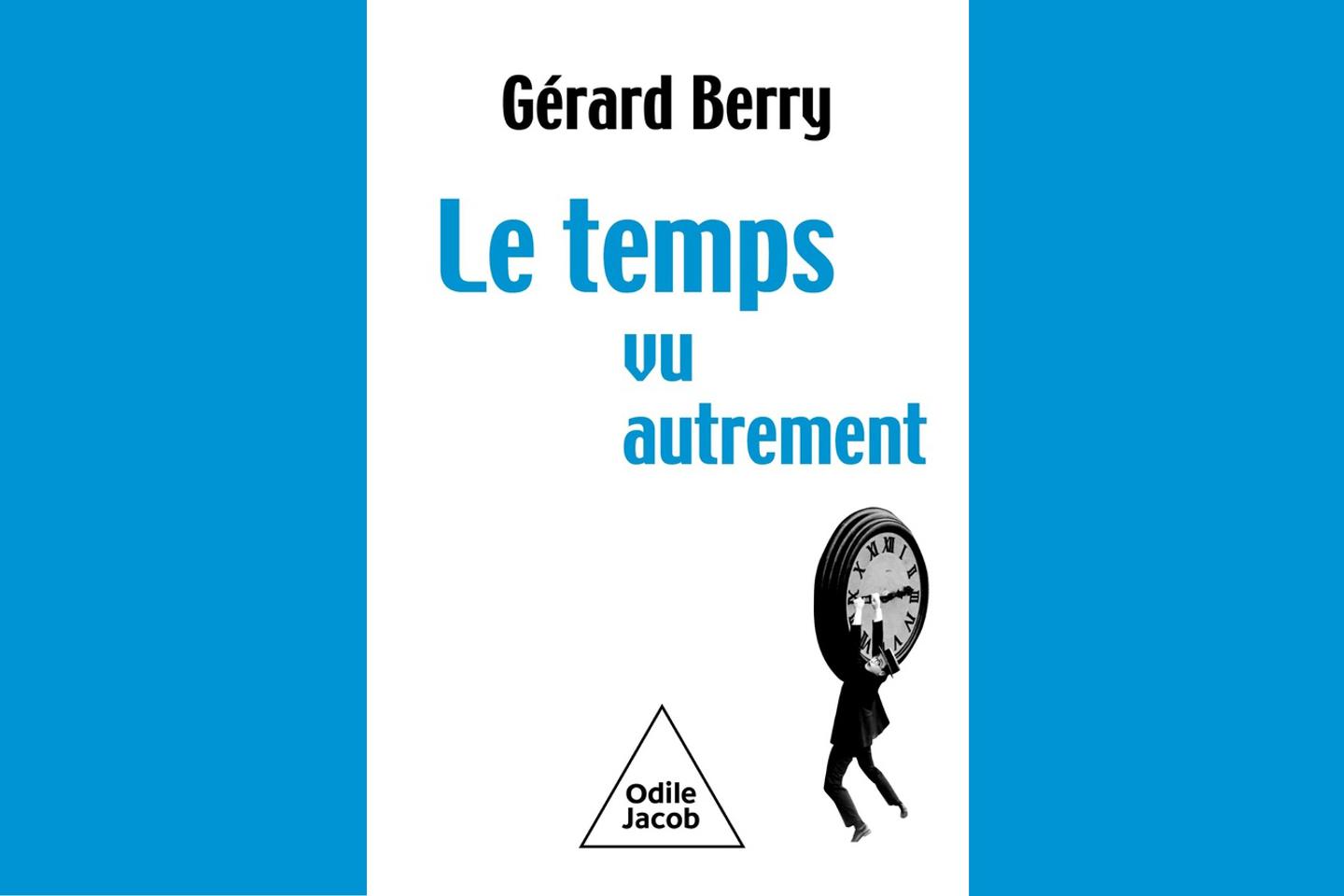Vu le sujet du dernier livre de l’informaticien Gérard Berry, ancien professeur au Collège de France, entrepreneur et chercheur médaillé d’or du CNRS, il serait tentant d’inviter le lecteur à prendre son temps pour savourer cet essai sur… le temps.
Non pas que les différents chapitres soient compliqués, mais parce qu’ils sont parfois si différents qu’une lecture intermittente, ou même dans le désordre, est possible. Le plaisir palpable de l’auteur à nous faire partager ce qu’il a lu – et surtout fait – sur le sujet le conduit à s’intéresser à beaucoup de facettes et à adopter des formes narratives variées.
Ainsi, deux chapitres sont inspirés de la pataphysique, mouvement scientifico-littéraire improbable : le premier s’amuse avec les expressions autour du mot « temps », le second s’attaque à la résolution de grandes questions de la physique contemporaine. Gérard Berry, membre du Collège de pataphysique, est aussi l’auteur d’une belle invention, la « déformatique », dont il donne la définition : « L’informatique c’est la science de l’information ; la déformatique c’est le contraire. » Le ton est donné.
Entre les deux, le lecteur, déjà déstabilisé ou diverti, trouvera des passages plus attendus sur la mesure du temps (horloges, clepsydres, calendriers…). Marque d’originalité, l’auteur parle aussi de la distribution du temps, à travers un ensemble de techniques (matérielles et logicielles) tout aussi capitales pour nos sociétés, du transport en train jusqu’à la géolocalisation par satellite.
« Interblocage » et « famine »
En revanche, un chapitre, très riche et technique, surprend par son lien ténu avec le sujet central. Il y est question d’ondes, dans tous leurs états. L’auteur glisse de la musique aux rayons X, en passant par le cerveau et la communication.
Les thèmes abordés par les trois derniers chapitres ont rarement été vulgarisés. Gérard Berry se trouve là sur son terrain de recherche et expose les trois manières de calculer, qu’il classe en fonction de la façon dont le temps est considéré. Première façon, les calculs sont effectués par opérations séquentielles, l’une après l’autre, comme à l’origine de la machine de Turing (qu’il explique !) et aujourd’hui encore dans nos ordinateurs. Le chapitre digresse aussi sur la notion de complexité des calculs et sur les problèmes « difficiles » à résoudre.
Il vous reste 28.91% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.