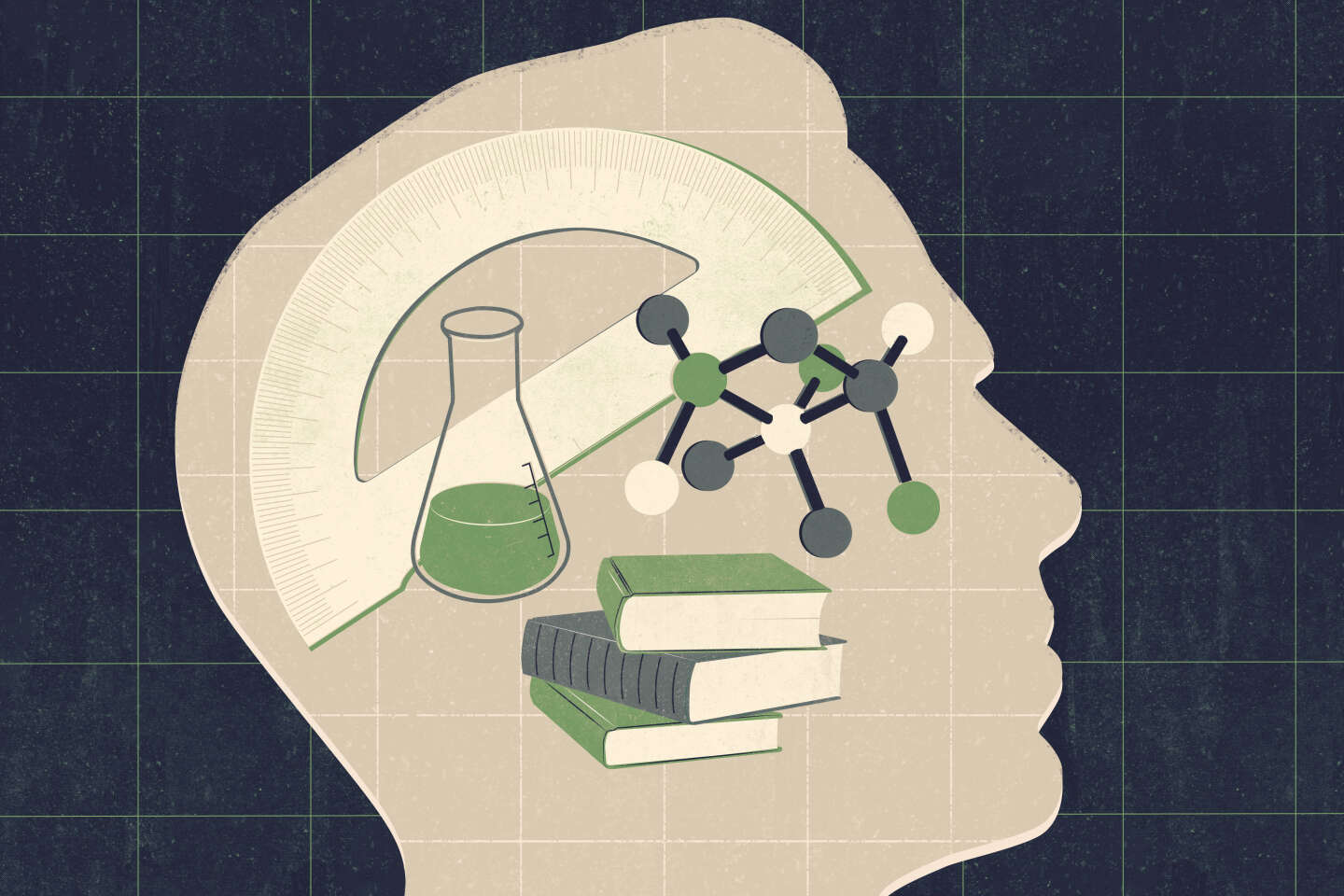Alors que le monde bruisse d’annonces inquiétantes en matière de politiques environnementales, l’histoire des sciences et de l’environnement apporte un éclairage nouveau sur le passé de ces écologies autoritaires. L’ouvrage de Marco Armiero, Roberta Biasillo et Wilko Graf von Hardenberg, Mussolini’s Nature. An Environmental History of Italian Fascism (« la nature de Mussolini, une histoire environnementale du fascisme italien », MIT Press, 2022, non traduit), s’interroge ainsi sur le naturalisme du régime fasciste, fondé sur un discours de régénération de la nature.
Selon les auteurs, au-delà de la protection de la nature, se dessine une vision paradoxale. Il s’agit, d’un côté, de célébrer dans une vision nationaliste le retour à la terre et à une nature idéalisée contre la barbarie de la civilisation urbaine, et, de l’autre, de s’appuyer sur un projet de modernisation technique, comme la canalisation des fleuves à Milan. Illustration de cette tension, cette période voit à la fois la création des parcs nationaux comme mesure de sanctuarisation d’espaces naturels au détriment de l’exploitation forestière, par exemple, mais aussi la poursuite d’un vaste plan d’élimination des « vermines » animales de ces mêmes espaces.
Ainsi, le ruralisme fasciste ne s’oppose pas à un volontarisme modernisateur en matière de logiques d’exploitation. Comme annoncé le 2 mars 1937 au Grand Conseil du fascisme, les sciences agronomiques, météorologiques ou l’ingénierie hydroélectrique sont constamment mobilisées pour soutenir une économie politique autarcique caractérisée par le « lien entre les choix nationalistes de politique économique, les visées expansionnistes et coloniales, et le totalitarisme rigoureux dans la gestion du pouvoir », le tout orienté vers la préparation à la guerre.
« Modernité alternative »
Le Duce lui-même déclarait, dès 1929, que « la recherche scientifique doit servir la science et les besoins nationaux ». En 1934, de manière à suppléer au manque de charbon et de pétrole, l’industrie hydroélectrique comme la production de gaz s’appuient sur les ressources forestières abondantes. Agronomes et chimistes sont mis à contribution pour alimenter les moteurs à gazogène des véhicules à partir des déchets de bois produits dans les fermes et les exploitations forestières.
Il vous reste 43.41% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.