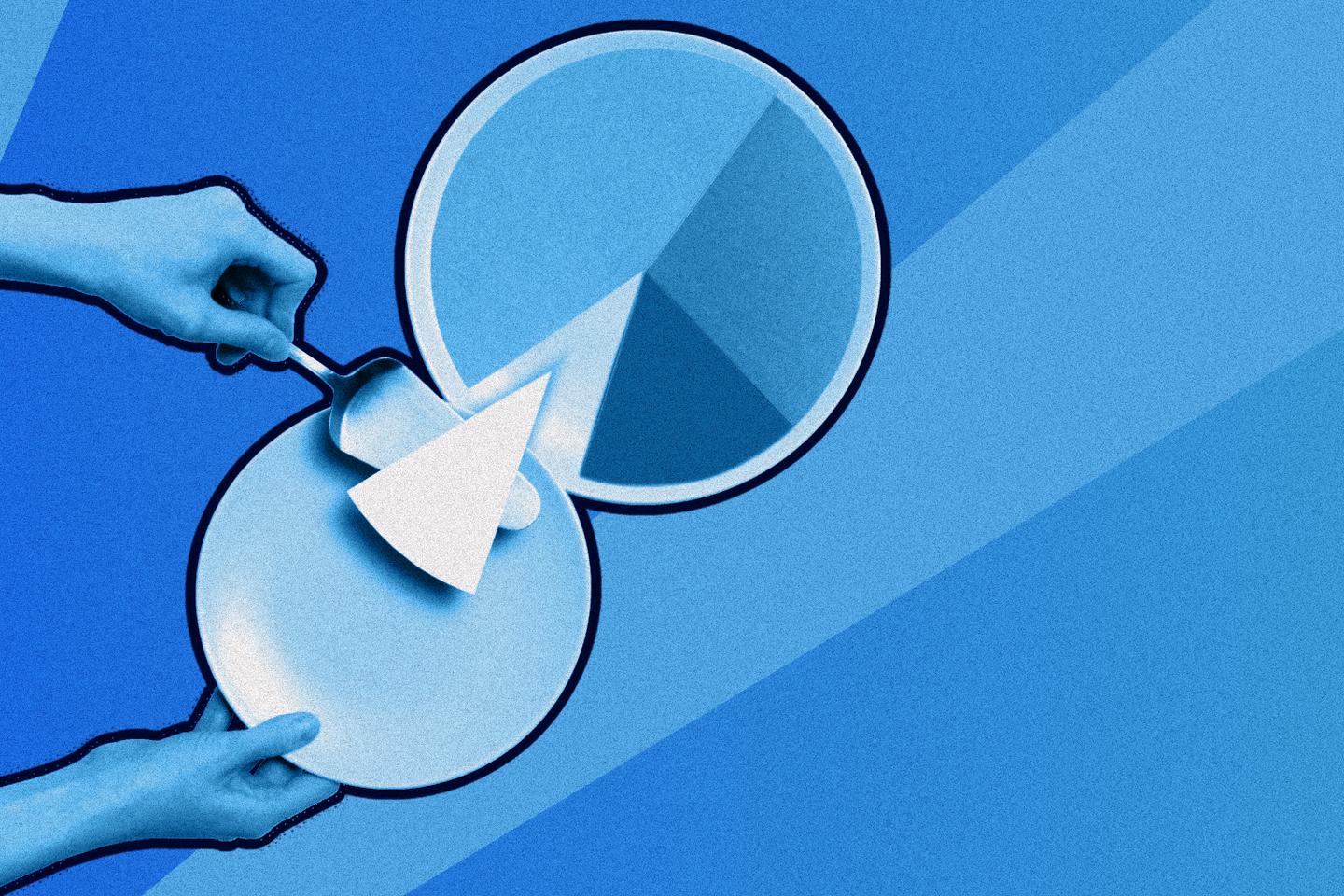Nous fêterons dans quelques jours les 80 ans de la Sécurité sociale. A un moment où la droite et l’extrême droite parviennent à saturer l’espace public en réduisant le débat à une opposition simpliste entre travail et assistanat – le capital ayant comme par magie disparu de l’équation –, il importe de rappeler le caractère révolutionnaire de cette institution, les ambitions qui ont présidé à sa création et la façon dont elles peuvent nous inspirer aujourd’hui.
L’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 explique de la manière la plus claire l’objectif principal de la Sécurité sociale : « Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. »
Sa vocation est donc, bien évidemment, de réduire les inégalités entre les bien portants et les malades, les célibataires et les chargés de famille, les actifs et les retraités, mais, plus fondamentalement encore, celles qui existent entre les individus possesseurs de leur seule force de travail et les propriétaires du capital. Les choses sont posées de façon on ne peut plus limpide dans le même texte : « Le problème qui se pose alors est celui d’une redistribution du revenu national, destinée à prélever sur le revenu des individus favorisés les sommes nécessaires pour compléter les ressources des travailleurs et familles défavorisés. »
Doit-on imputer la radicalité de ce texte au fait qu’une partie de ses inspirateurs appartenait au Parti communiste français et à la Confédération générale du travail ? Nullement. En effet, outre qu’il est aussi le fruit du travail du Conseil national de la Résistance, il porte fortement la marque de Pierre Laroque (1907-1997), issu d’une tout autre tradition : conseiller d’Etat et spécialiste des assurances sociales, il a rejoint Londres et le général de Gaulle en 1943. Ses nombreux écrits, antérieurs et postérieurs à 1945, permettent de prendre l’exacte mesure de ce qu’il qualifie de « révolution conceptuelle ».
Il vous reste 60.84% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.