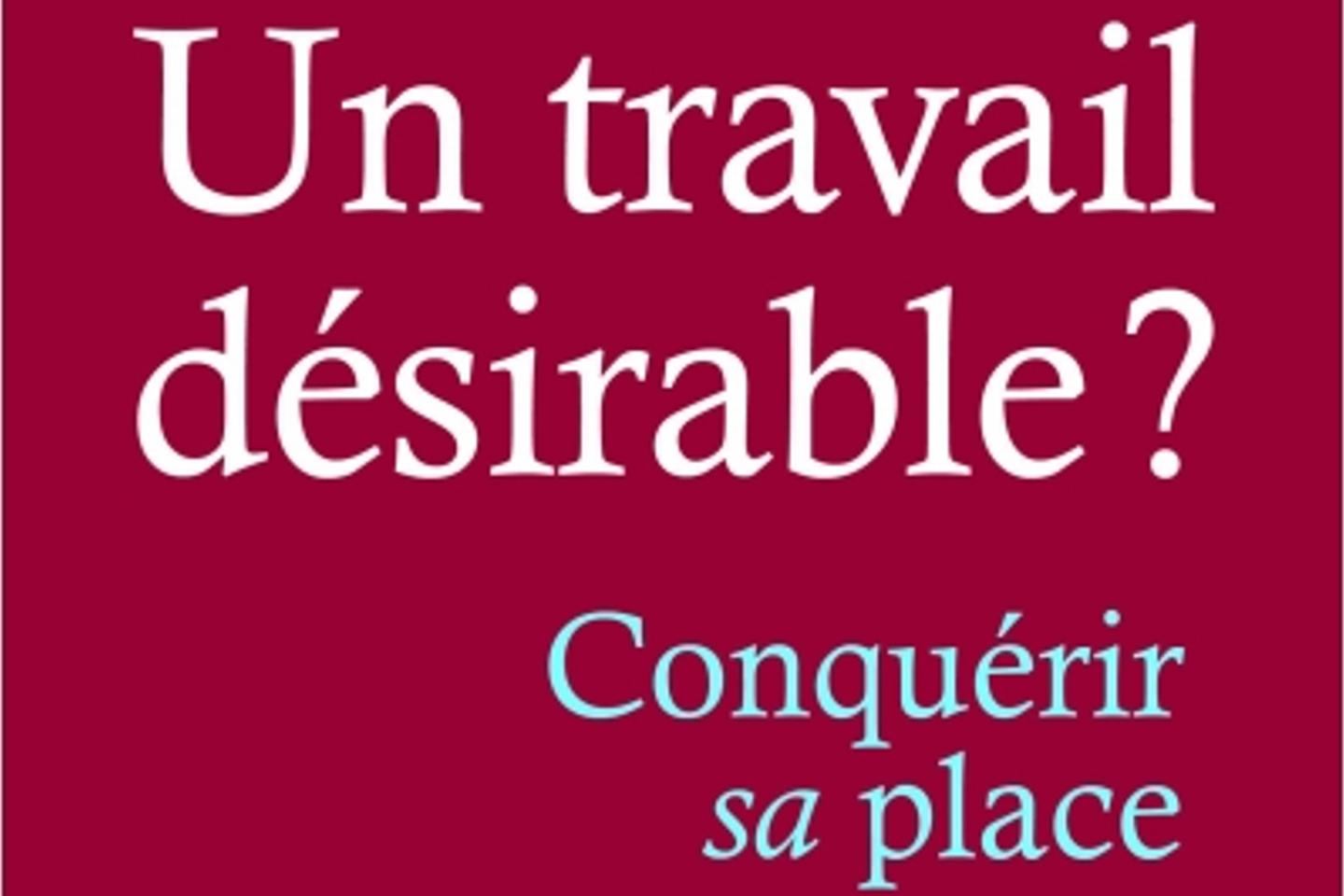Dominique Lhuilier, professeure émérite de psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et Anne-Marie Waser, sociologue, maîtresse de conférences au Cnam, démontrent à travers Un travail désirable ? Conquérir sa place (Les Petits Matins, 272 pages, 23 euros) l’ambivalence de l’activité professionnelle, qui peut être tout à la fois « éprouvante pour la santé » et « source de santé ».
Votre ouvrage propose une vingtaine de récits de vie qui mettent en lumière des travailleurs en souffrance, privés de travail ou touchés par le mal-être en milieu professionnel. Quelles sont les racines de ce « travail empêché » ?
Dominique Lhuilier : A travers notre ouvrage, nous avons voulu mettre à mal des stéréotypes qui pèsent lourdement sur ceux qui n’arrivent pas à entrer dans le monde du travail, à s’y maintenir, ou ceux dont les carrières sont marquées par la précarité. Certains d’entre eux vont être qualifiés d’inemployables : on leur attribue un déficit rédhibitoire (en compétences, qualification, motivation, santé…). D’autres sont assimilés à des assistés, qui profiteraient des allocations chômage, du revenu de solidarité active (RSA).
Nous montrons au contraire que l’empêchement subi par de nombreux travailleurs est socialement construit. Les seniors, par exemple, sont exclus et mis au rebut en raison de leur âge. Les femmes, quant à elles, sont assignées à l’espace domestique et familial. Conquérir une place dans le monde professionnel est donc particulièrement complexe pour elles… Et puis, au-delà, on observe de grandes transformations dans le monde du travail qui peuvent toucher tout un chacun, et qui entraînent une précarisation des emplois, une fragilisation de la santé.
Anne-Marie Waser : Lors des entretiens que nous avons menés, nous avons rencontré des personnes non pas fainéantes, mais « cassées ». C’est le coût des évolutions majeures que connaissent les organisations. Les travailleurs peuvent se retrouver à des postes où, telles des machines, ils doivent suivre des processus, des procédures, et réaliser les missions exigées par l’entreprise. Celle-ci ne se demande pas si le travail les intéresse, ni comment le rendre intéressant. De telles réflexions, pourtant fondamentales, n’existent plus, alors que l’individualisation des tâches se développe et que les espaces de régulation pour évoquer, justement, les questions liées au travail, disparaissent.
Il vous reste 63.64% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.