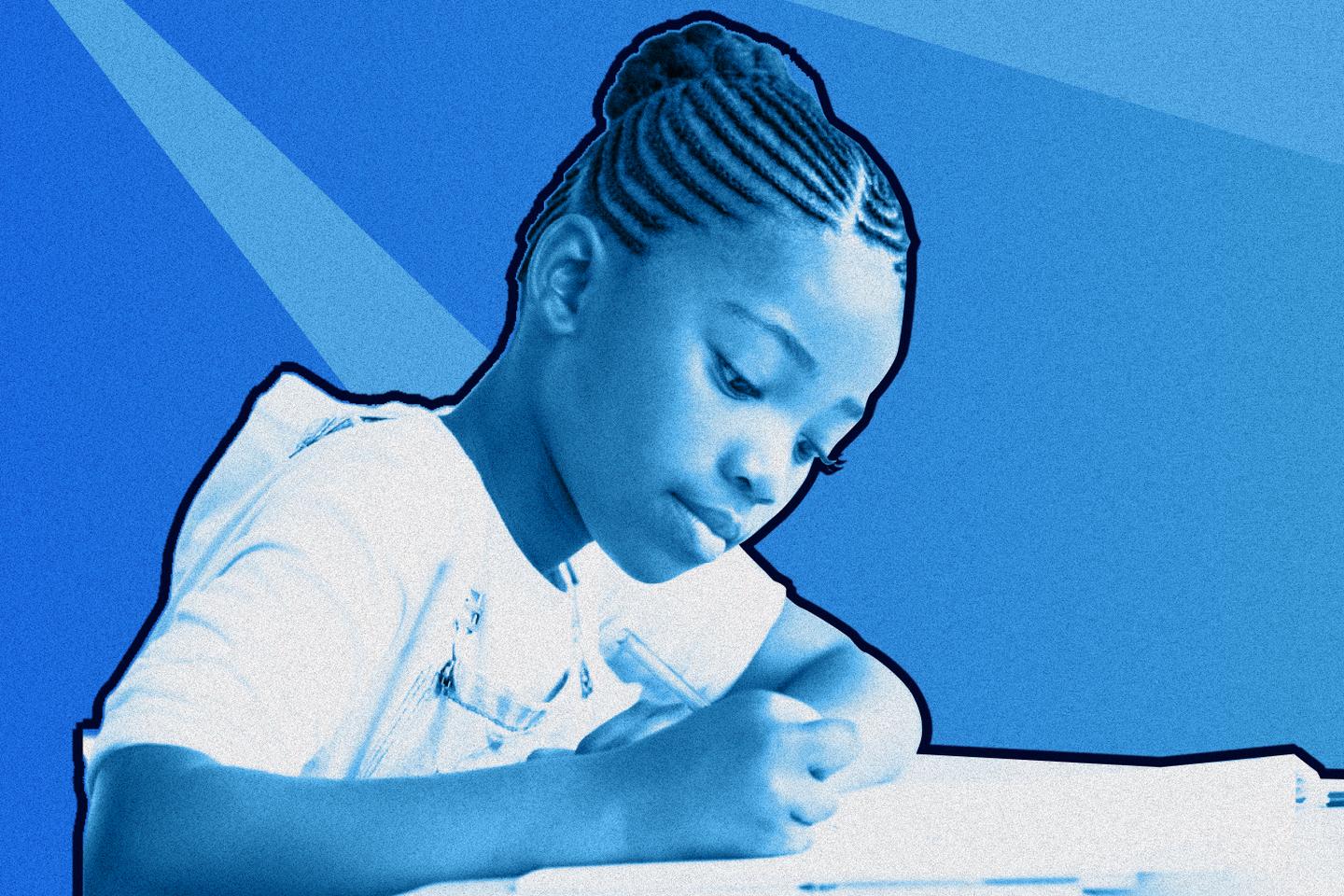Cette tribune paraît dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au Monde, vous pouvez vous inscrire à cette lettre hebdomadaire en suivant ce lien.
Le développement de l’intelligence artificielle (IA) générative interroge légitimement les systèmes éducatifs. Certains s’inquiètent qu’elle ouvre la porte à l’industrialisation de la fraude et cherchent de nouvelles méthodes d’évaluation, faisant plus de place à l’oral et à la créativité, plus attentives à la démarche qu’au résultat. D’autres réfléchissent à l’évolution du rôle des professeurs dès lors que la machine s’avérerait plus performante qu’eux pour délivrer des informations et garantir des acquisitions. Tous voient bien qu’il est impossible d’ignorer les bouleversements induits par une technologie que les élèves et les étudiants commencent à utiliser massivement.
Mais il demeure la question, trop souvent oubliée, des effets de l’arrivée de l’IA sur l’organisation même de notre institution scolaire. C’est pourtant sur ce point que les thuriféraires de la « machine enseignante » insistent aujourd’hui, aussi bien aux Etats-Unis qu’en France. Leur raisonnement est simple : l’échec de l’école, que révèlent largement les enquêtes internationales comme les tensions institutionnelles entre les parents et les professeurs, tient à l’ambiguïté de son projet. Elle prétend assurer, en même temps, la transmission et la socialisation.
Or ces deux missions, expliquent-ils, sont contradictoires. Pour être efficace, la transmission doit être individualisée, adaptée aux rythmes et profils des apprenants. Et, comme il est impossible pour un enseignant de différencier son enseignement pour s’adapter à chacun et chacune (en témoignent les difficultés de l’école inclusive), il faut confier cette fonction à la machine : avec l’IA, on peut, en effet, identifier précisément les caractéristiques cognitives, affectives et sociales d’un individu afin de construire un programme d’enseignement strictement adapté à ses besoins, accessible en permanence et capable de l’amener bien plus efficacement à des connaissances de haut niveau qu’un enseignement collectif inévitablement grevé par une hétérogénéité irréductible…
Il vous reste 70.27% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.